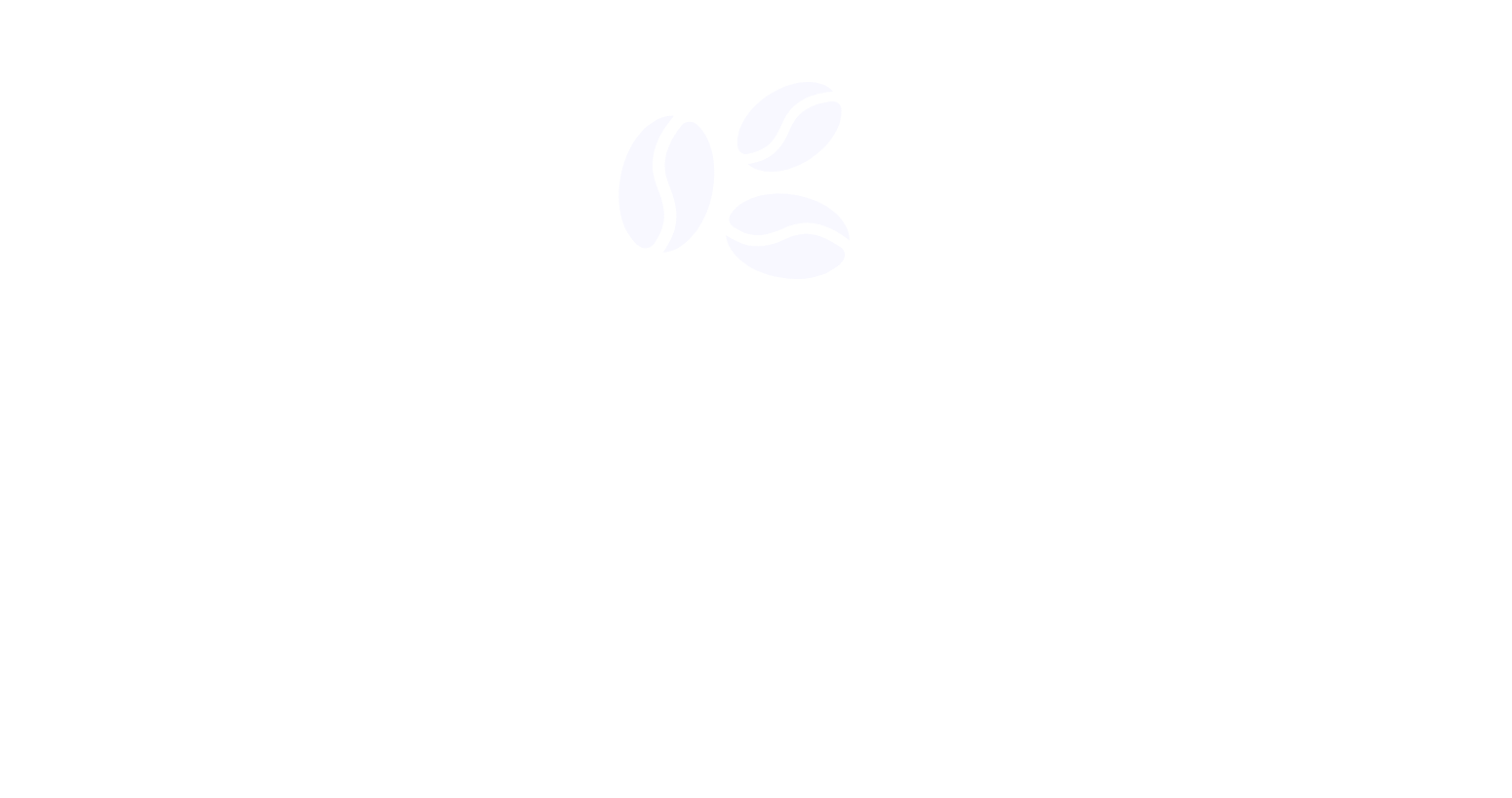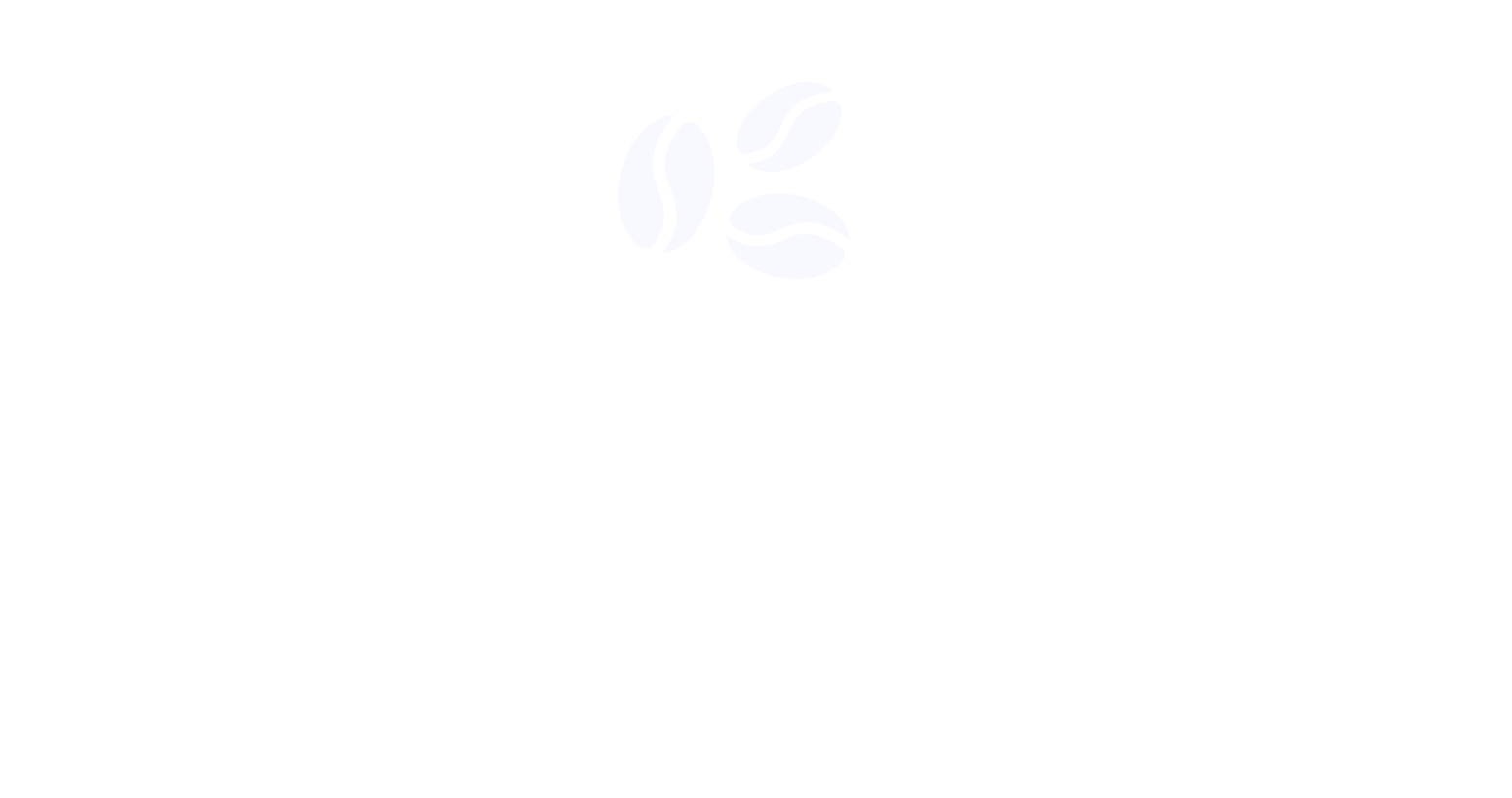Un séchage naturel pour développer tous les arômes
Après la récolte des cerises de café, ces dernières passent par une phase de transformation (fermentation, lavage, dépulpage selon le procédé). Mais une fois que le grain — encore entouré de mucilage ou de parchemin — est humide, il est vulnérable : moisissures, altération aromatique, oxydation, développement microbien… Le séchage devient alors une étape essentielle pour stabiliser le grain, sécuriser sa conservation et préserver ses qualités organoleptiques.
La méthode utilisée, sa rapidité, son uniformité et sa régularité influencent directement la saveur, l’arôme, la densité et la qualité globale du café.


Le point de départ : le grain humide et ses défis
Le café fraîchement fermenté présente un taux d’humidité relativement élevé — on parle souvent de 55 à 60 % (base humide) immédiatement après les étapes initiales.
Le but est de réduire cette humidité jusqu’à environ 10–12 %, niveau de stabilité attendu pour le transport et le stockage.
Pendant le séchage, les phénomènes physico-chimiques sont nombreux : migration interne de l’humidité vers la surface, évaporation selon la pression de vapeur, ralentissement progressif du processus lorsque le grain se déshydrate (phase descendante ou « falling-rate »)
Le rythme de séchage : lent, progressif, contrôlé
Le séchage sur ces tables est conçu pour être lent, typiquement sur plusieurs semaines.
Quelques pratiques courantes :
- Brassage / retournement régulier : plusieurs fois par jour, on retourne le café pour exposer toutes les faces au soleil et à l’air. Cela évite les points chauds ou les zones humides persistantes.
- Surveillance : on contrôle l’humidité, l’apparence du grain, détecte les signes de fermentation excessive ou de moisissure.
- Protection la nuit ou en cas de pluie : on couvre parfois les grains sous bâches, ou on monte des abris ou simples voiles pour les protéger de l’humidité ou des intempéries. Par exemple, certaines plantations de Blue Mountain utilisent des structures parabolique transparentes pour maintenir un équilibre thermique.
- Paliers de séchage : dans certains cas, on peut « reposer » le grain une nuit, puis poursuivre le séchage, afin de laisser l’humidité se redistribuer ; cela peut améliorer l’intégrité cellulaire du grain.
Selon les conditions climatiques (ensoleillement, humidité relative, vent), le séchage peut durer 8 à 15 jours pour la méthode lavée (wet) sur tables élevées avant de descendre à 10-12 % d’humidité. Pour le procédé « naturel » (où la cerise entière sèche), le temps peut être plus long : 3 à 6 semaines selon les conditions.